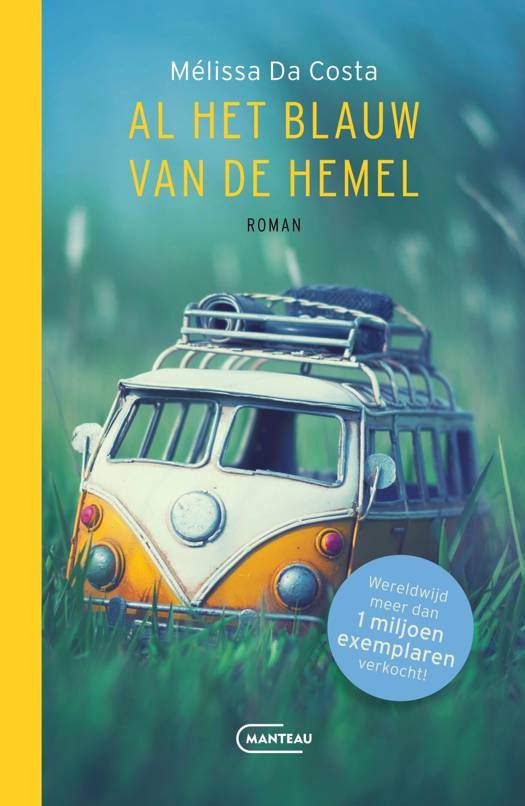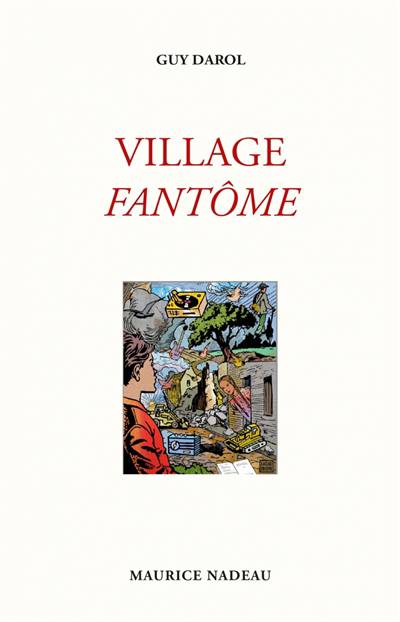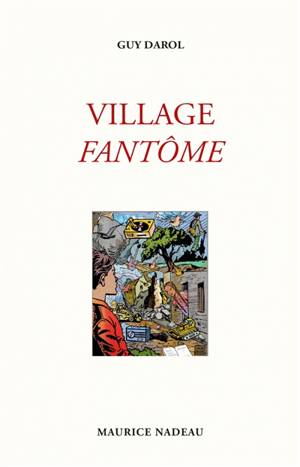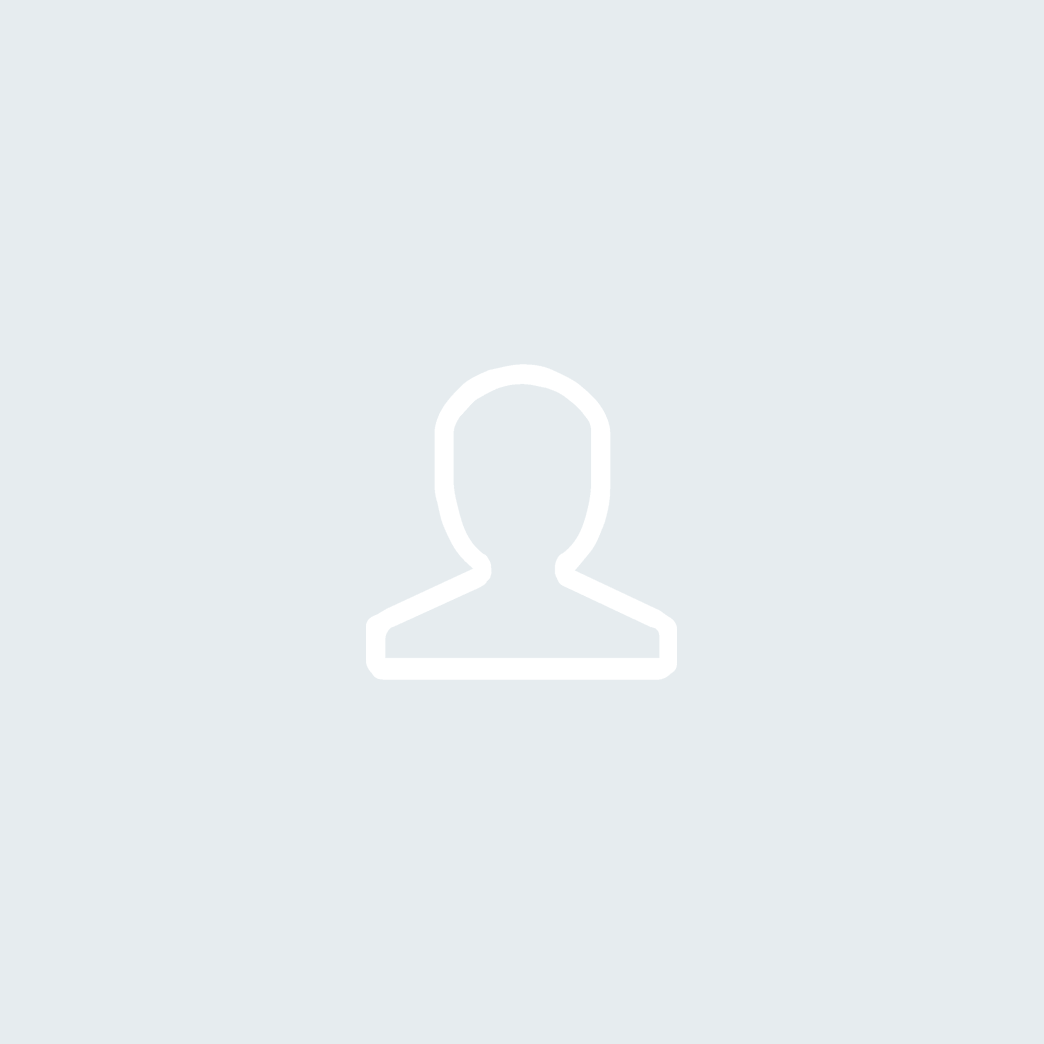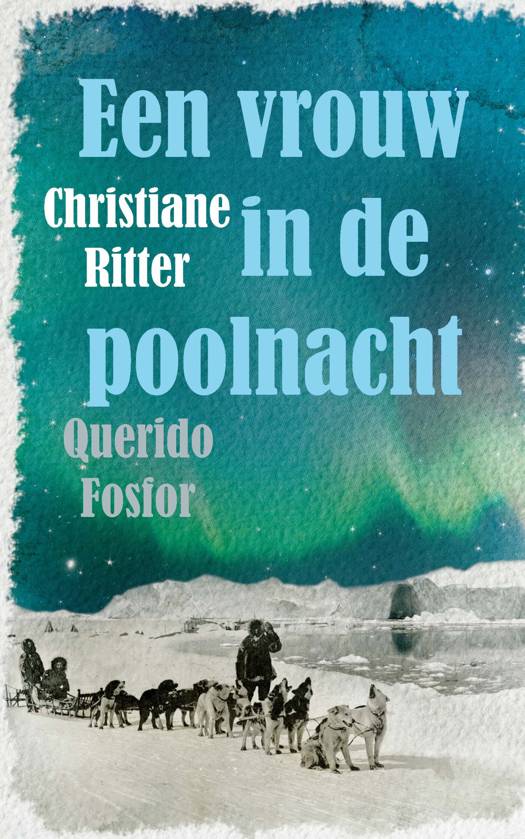
- Afhalen na 1 uur in een winkel met voorraad
- Gratis thuislevering in België vanaf € 30
- Ruim aanbod met 7 miljoen producten
- Afhalen na 1 uur in een winkel met voorraad
- Gratis thuislevering in België vanaf € 30
- Ruim aanbod met 7 miljoen producten
Omschrijving
L'exploitation d'une carrière de granit met en péril plusieurs villages autour d'un bourg de Haute-Bretagne. L'un d'eux, La Ville Jéhan, entièrement détruit, appartient aux souvenirs de Guy Darol qui y a vécu tous les étés de son enfance, auprès de ses grands-parents, jusqu'en 1971. Devant une telle désolation, il a reconstruit de mémoire un ensemble de fermes aujourd'hui disparues et donné vie aux anciens habitants en s'attachant à détailler tous les aspects de leur quotidien. Du battage des blés à la fabrication du pain, La Ville Jéhan témoigne d'un temps où les solidarités et l'autosuffisance étaient les moyens et le but. Un tableau se dessine, celui d'un village d'autrefois dont les principes fondés sur l'économie du peu fait écho à l'idéal d'entraide que l'on cherche désormais à réhabiliter comme une utopie nécessaire.
« Laboureurs ils l'étaient toujours, mais comme on avait besoin de ferrer les chevaux, de bâtir ou de consolider des maisons, de fournir des charrettes, de manchet des fourches, des binettes, de façonner des habits et des draps, ceux-ci se partageaient entre leurs bêtes à cornes, leurs pourcés, les champs de patates ou de blé, et les métiers de passion ou de chien qu'on leur avait appris. Et c'est pourquoi les enfants devaient cracher dedans, venir en secours après l'école, quand ils y allaient. Leurs mères relevaient les manches pour traire les vaches, mener les chevaux et le brabant, laver au dué, saigner les lapins et les poules, les vider ou les dépouiller, fendre le bois, en plus de cuisiner le fricot.
La Ville Jéhan comptait un grand nombre de veuves dont les époux, tombés dans la série des guerres, avaient été charron, carrier, tisserand, tonnelier ou encore forgeron, menuisier. Ce qu'on ne trouvait pas au village, on allait le chercher au bourg, chez le sabotier, le bourrelier, le sellier, celui qui vous vendait des herses et des semoirs, des moissonneuses et des tombereaux.
Toutes ces explications récompensaient mes tours de manivelle maintenant que la faucille était parfaitement aiguisée. Car je comprenais mieux ce qu'était, ou avait été, la vie de mon village. Presque coupé du monde, un noyau dur de savoir-faire et de solidarités où l'on n'importait rien, et rien ne s'exportait puisque l'indispensable y était produit qui se donnait ou s'échangeait en trésors d'existence. »
« Sous quel orage d'acier est tombé mon village ? Un bombardement n'aurait jamais fait pire. Je roulais au pas, m'arrêtais un moment devant un tas de pierres, vestige de la maison de mes grands-parents où je reconnaissais les débris d'un vaisselier, un trépied de cheminée, des éclats de faïence bleue, un sarrau devenu chiffon. Seuls le puits et son auge avaient été épargnés ainsi que la maison d'Alain Urvoy. Ce camarade de jeunesse s'était-il barricadé pour interdire la marche des machines ? Forcené contre les pelleteuses, il avait, j'imagine, hurlé qu'on ne le délogerait pas, sinon mort. Je ne voulais pas aller du côté des fermes d'en bas que je supposais en miettes. Sur ma droite la maison de Constance Rouvray, voisine de celle de mes parents, était un éboulis de poutres, d'ardoises, de moellons et de fer. Au loin, dans la cour de Marcel Binard, deux ouvriers maniaient la pelle avec une bonne humeur à pleurer. Je regardais le chemin qui menait à Camblot, l'herbe y poussait encore, et je repris la route sans jeter un oeil dans le rétroviseur, la gorge et le coeur serrés. »
Alleen bij Standaard Boekhandel
Beoordelingen
We publiceren alleen reviews die voldoen aan de voorwaarden voor reviews. Bekijk onze voorwaarden voor reviews.