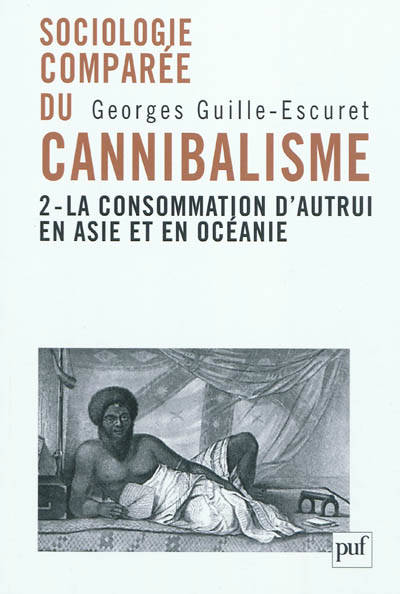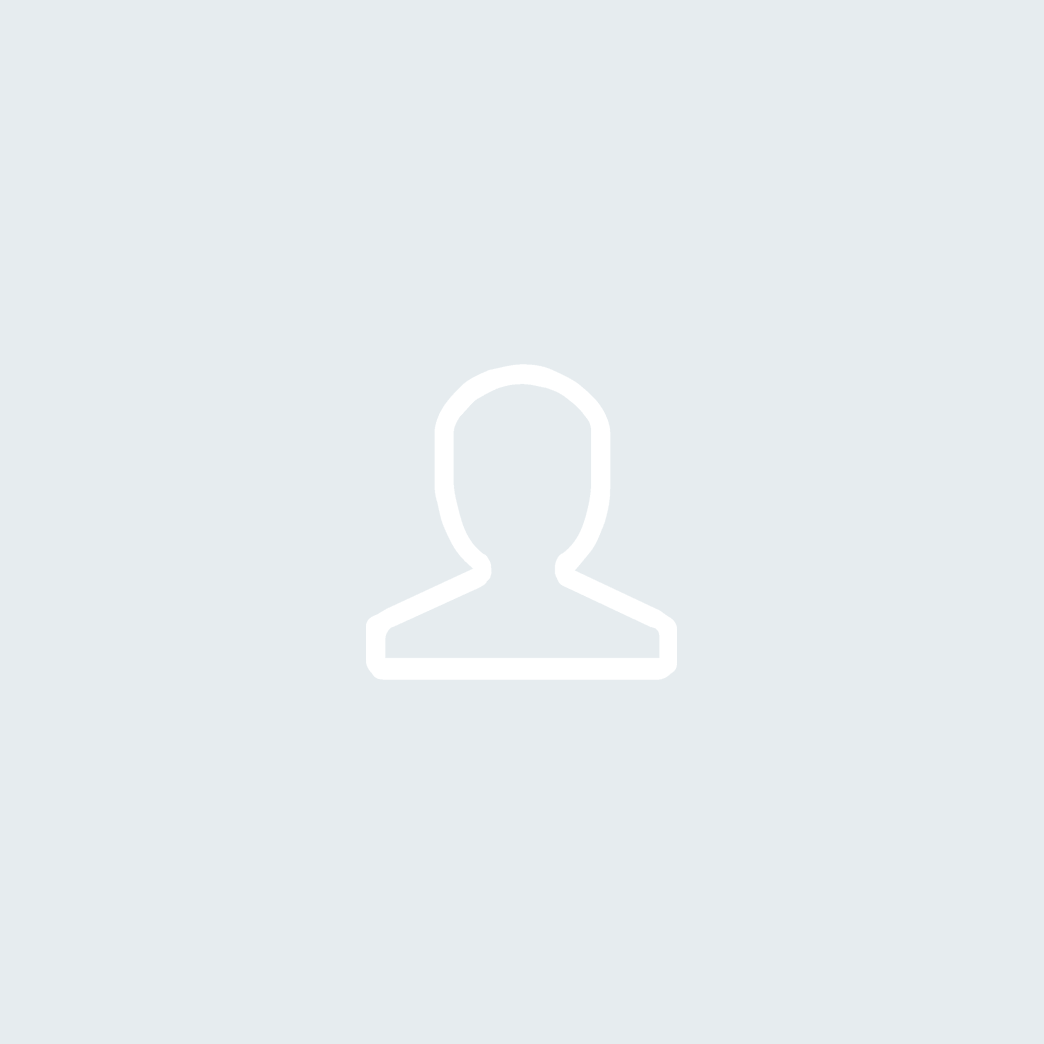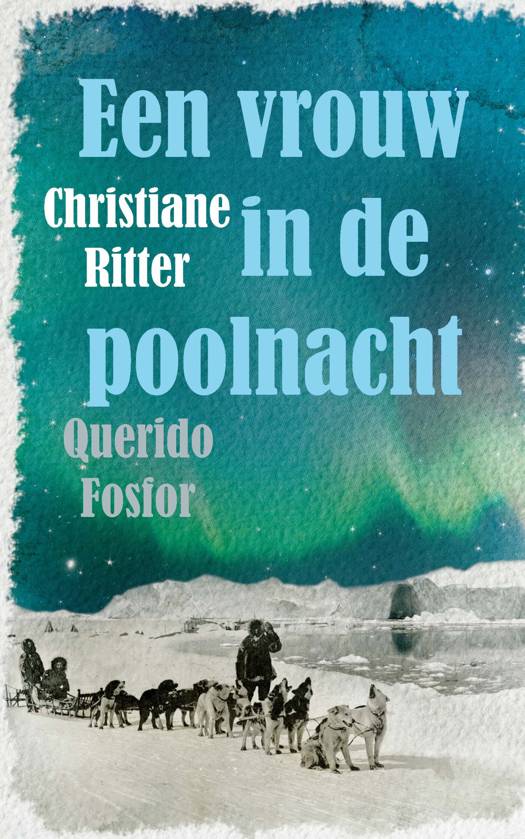
- Afhalen na 1 uur in een winkel met voorraad
- Gratis thuislevering in België vanaf € 30
- Ruim aanbod met 7 miljoen producten
- Afhalen na 1 uur in een winkel met voorraad
- Gratis thuislevering in België vanaf € 30
- Ruim aanbod met 7 miljoen producten
Omschrijving
Autant, dans le premier volume, le cannibalisme africain a sans cesse paru
répliquer aux aléas de la traite esclavagiste, autant, en Asie et en Océanie, c'est
la diversité des expressions et des contextes qui s'impose en priorité à l'observation.
Même parmi les peuples où des institutions admettent et réglementent
son éventualité, la fréquence et les modalités pratiques de l'anthropophagie
subissent des variations considérables au gré des circonstances écologiques
et historiques. Elle s'oppose alors aux rituels de la chasse aux têtes qui tendent
au contraire à se spécialiser et résistent davantage au changement : le cannibalisme
se caractérise en contraste par sa plasticité.
Sporadique et conjoncturel dans des sociétés égalitaires où il participe à
une retenue de la violence, on le voit devenir frénétique quand, par son truchement,
le chef veut affirmer une suprématie sur des rivaux. Une limite toutefois :
le maître qui accumule la consommation de ses congénères peut bien devenir
divin, mais non souverain. Le monarque authentique, lui, fonde l'État en rejetant
le comportement du fauve. Néanmoins, l'absence générale d'une rupture
déclarée de la culture avec la nature engendre au XXe siècle quelques jaillissements
inattendus de la prédation sur autrui (Seconde Guerre mondiale, Révolution
culturelle, etc.) où le «civilisé» patenté mime un «sauvage» refoulé en lui.
Selon un vieux poncif, le cannibalisme révèlerait un manque de contrôle
social, donc une inaptitude à garantir l'ordre. En réalité, chaque société pense
à sa façon les excès et les restrictions : fureurs honorables, désordres excusables
et transgressions intolérables. Parfois, le plus redoutable des mangeurs
d'hommes ne fait qu'obéir à un mode de vie très contraignant.
Specificaties
Betrokkenen
- Auteur(s):
- Uitgeverij:
Inhoud
- Aantal bladzijden:
- 409
- Taal:
- Frans
- Reeks:
- Reeksnummer:
- nr. 2
Eigenschappen
- Productcode (EAN):
- 9782130591665
- Verschijningsdatum:
- 1/02/2012
- Uitvoering:
- Paperback
- Afmetingen:
- 150 mm x 220 mm
- Gewicht:
- 588 g
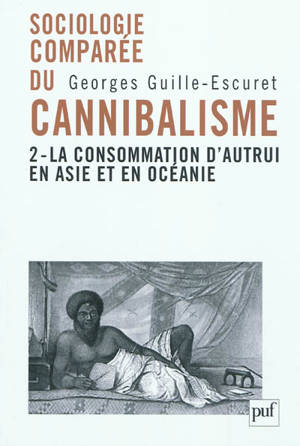
Alleen bij Standaard Boekhandel
Beoordelingen
We publiceren alleen reviews die voldoen aan de voorwaarden voor reviews. Bekijk onze voorwaarden voor reviews.